Q comme Le QUINIO
Il est né le 15 mars 1755 à Sarzeau, rue de la Trinité, de Nicolas Gildas Le QUINIO et de Julienne VALLÉ. Son père est chirurgien du roi, juré pour les rapports sur la Presqu’île de Rhuys. C’est-à-dire qu’il effectue des constats et/ou des autopsies et ses rapports sont légitimes dans les procès s’il y a lieu. Son grand-père, Gabriel Le QUINIO était lui aussi chirurgien. Tous sont nés à Sarzeau. Par contre leur ancêtre Sylvestre, né en 1639, est originaire de Surzur.
Marie Joseph est le 13ème et dernier enfant de la fratrie. La famille n’est pas riche, imposé à 6 livres 10 sols alors que le menuisier Conan lui est imposé à 11 livres. Toutefois, la famille côtoie la petite noblesse et bourgeoisie de la commune, dont on retrouve les noms lors du baptême des enfants. Dans cette partie bretonne, la religion enveloppe de longue date la société et deux générations de Le QUINIO, compte chacune un homme d’église, mais on trouve aussi un attachement à la culture bretonne, dans le fait que le père de Joseph Marie se prénomme Gildas. Saint de la chrétienté celtique la plus pure, qui trouva asile sur nos côtes au VIe siècle. Il y a aussi plusieurs communautés religieuses et au recensement ecclésiastique de la paroisse, en 1748, on dénombre, un recteur, deux curés et 8 prêtres, ce qui est supérieur à la moyenne des paroisses du Morbihan.
Marie Joseph vit donc son enfance dans une ambiance religieuse importante, sombre et pesante, dû à un Jansénisme pur et dur instauré par l’évêché de Vannes avec tout un cortège d’obligations et d’interdits stricts. Il voit autour de lui un petit peuple miséreux, méprisé par la hiérarchie ecclésiastique. En effet les prêtres souvent issus des rangs du peuple, ne doivent pas participer aux fêtes et ils sont obligés à un rôle de censeurs permanents vis-à-vis des fidèles.
A cette époque encore, ce peuple miséreux est enfermé dans le système féodal qui l’empêche d’être propriétaire, même du plus petit lopin de terre. Les communaux qui autrefois appartenaient à tous et à personne, ont été intégrés dans les biens nobles. Pourtant, moyennant une certaine redevance il est possible d’acquérir des terres, que des propriétaires nobles endettés vendent ou louent. C’est l’afféage. Gildas Le QUINIO, se retrouve, ainsi seigneur du domaine de Kerblay. Et la vie de la famille se fait un peu plus confortable qu’avec les seuls revenus de sa charge.
Mais, pour rentabiliser son investissement, il se voit obligé de demander encore plus aux paysans pour en retirer un revenu supérieur à la redevance. Cette surcharge de travail crée une animosité grandissante autour de sa personne. Il est souvent menacé, pris à parti. La vie miséreuse autour de laquelle le sentiment de mort est omniprésent dès le berceau, crée une violence intrinsèque dans cette société de la Basse-Bretagne, où la terre ingrate offre peu de rendement, des frustrations multiples chez des gens pauvres culturellement et peinant à s’exprimer. C’est ainsi que Gildas, est retrouvé mort dans un champ près de son domicile de Kerblay. Après autopsie, il s’avère qu’il a été violemment trappé avec une pierre entraînant une hémorragie cérébrale, cause de la mort. La coupable, Françoise Largouet, s’enfuit et ne sera jamais retrouvée. La population faisant en grande partie, bloc pour la protéger.
Joseph Marie a deux ans, à la mort de son père. Il est élevé et éduqué par sa mère, et il dit même qu’il est choyé. Au décès de sa mère en 1777 il écrit :
« Tu ne seras plus, tendre et respectable mère, qui formas mon cœur à l’affection et qui me donnas le jour moral après m’avoir donné l’être ; ô mère chérie ! Par qui j’ai vécu ; toi qui semblais n’exister que pour moi ; toi qui suffisais à mon bonheur, tu ne revivras jamais. Je ne recevrai plus tes tendres embrassements, et tu ne recevras plus les miens… »
C’est cette mère aimante et aimée de lui qui marquera ses années de jeunesse et contribuera à façonner sa personnalité. Éduqué sans aucun doute dans la foi catholique, mais avec une morale personnelle et aussi un peu de libre arbitre. Toutefois le catéchisme est enseigné en langue bretonne, ce contre quoi s’insurgera Joseph Marie. Cependant le domaine de Kerblay ne suffit pas à les nourrir et la famille tombe dans une certaine indigence, car son imposition n’est plus que de 2 livres, pour les années 1757 et 1758. A 7 ans, l’indigence l’oblige à quitter sa mère. Sans doute est-il accueilli par les Trinitaires, où son frère ainé Jean s’y trouve déjà depuis 8 ans. La vocation de cet ordre est le secours aux indigents et aux malades. Il suit un enseignement normal auprès des maîtres et maîtresses dont la ville est pourvue. Il est attentif, il a l’appétit de connaître et le goût de la besogne, il est avide de connaissances et la bibliothèque de l’ordre lui fourni plus de 500 ouvrages, religieux bien sûr, mais aussi sciences, histoire, arts, mathématiques, philologie.
A l’adolescence, il quitte l’ordre pour se joindre aux paysans.
« Depuis l’âge de quinze ans, il a vécu au milieu des agriculteurs les moins instruits de la France entière, en Basse-Bretagne, tenant plus souvent le râteau que la plume, travaillant avec les hommes de peine et, comme eux, vivant avec eux dans le plus grand dépouillement… »
Paru dans le Moniteur universel,
C’est le temps où il découvre « les habitations de la classe pauvre » dans le Morbihan : « Ce sont de misérables huttes de boue, sans vitre, presque sans lumière. Elles ont une cheminée de terre… » L’auteur ajoute : « Des cabanes presque aussi mauvaises que les pires d’Irlande. » Quelques bancs, des lits clos, voire une simple couchette, quelques coffres ou armoires constituent le patrimoine mobilier du laboureur. Joseph-Marie apprend ce qu’est la condition du paysan. Il ne pouvait en soupçonner la dureté. « Je voyais le laboureur écrasé sous le poids des fatigues et de la misère […] pour qui le jour de la prière est le seul jour de son repos. » Arthur Young, voyageur anglais.
Joseph Marie rédigera plus tard de cette expérience les commentaires suivant :
« Je voyais le pauvre habitant des campagnes, dont la fortune la plus assurée consiste dans le nombre de ses enfants parce que dès l’âge de cinq ou six ans ils lui sont utiles […], je le voyais soumis à l’emprise désastreuse de l’habitude et des préjugés, réclamer contre cette éducation qui lui enlève des bras. »
« Le morbihannais n’est point stupide, il s’en faut. C’est un homme de feu, l’étincelle est dans ses yeux quand il naît. La fougue est dans ses mouvements. Mais hélas ! Il est encore plus de flamme dans son cœur et c’est avec son cœur que l’on étouffa son esprit ; c’est en allumant dans son âme tous les feux de la superstition que, par génération et par siècle, on le dégoûta du bien présent. C’est enfin sous l’égide sacrée qu’on lui met la torche de la guerre civile et le poignard dans la main… »
Arthur Young décrit ainsi les gens du petit peuple du Morbihan :
« Les hommes portent des pantalons larges mais qui s’arrêtent au genou, comme des culottes ; ils ont en effet les jambes nues et la plupart sont chaussés de sabots. Ils ont des traits accentués comme les Gallois, avec la même attitude à la fois énergique et nonchalante. Leurs corps sont forts, larges, carrés d’épaules. Les femmes sont ridées par le travail, avant l’âge, au point qu’elles ont perdu toute la grâce de leur sexe… » Cf. Voyage en France, op. cit., p. 234
La religion a instrumentalisé cet être jadis juste et bon, mais prisonnier d’un héritage mental aux lointaines origines.
« C’est en Bretagne surtout qu’à l’abri de l’ignorance sont restées les mœurs sauvages et dures, une langue barbare qui conserve encore un mur de séparation entre les habitants des campagnes et le peuple des cités, interdit entre eux presque toute communication et maintient les premiers dans un caractère de rudesse qui n’échappe aux yeux d’aucun voyageur »
« Instruisez-vous donc sans quitter vos champs et sans abandonner votre état »
C’est ce qu’il continua à faire une fois sa besogne aux champs terminée. Mais de lui-même ou par la volonté de son entourage, il va poursuivre sa formation pour 3 années supplémentaires, au collège Saint-Yves à Vannes. Il a alors 16 ou 17 ans. Les cours sont en latin, et le but de l’établissement est de forger les futurs cadres religieux et laïcs du pays. Si les cours sont gratuits il lui a fallu des aides pour payer son hébergement et sa nourriture. Sans doute des personnes de son entourage l’ont-ils aidé. Son frère Jean, prêtre aux Trinitaires ou Nicolas, chirurgien ?
Il y apprend entre autre la philosophie et la rhétorique. Il est marqué par les œuvres d’Esope, Voltaire et Rousseau.
Après Vannes il est admis à la faculté de droit à Rennes en 1774. Il côtoie de nombreux autres étudiants, surtout de la noblesse, avec des noms de famille à particule. C’est à cette époque qu’il accole à son nom Le QUINIO celui du domaine de son père, de Kerblay. Il devient Joseph Marie Le QUINIO de Kerblay. En plus des cours de droit juridique, il s’inscrit en droit canonique. L’ordre ecclésiastique est très présent en Bretagne, et les juristes sont amenés à plaider dans les juridictions ecclésiastiques. Après 3 ans d’études, il est reçu et obtient son baccalauréat de droit.
L’avocat des justes causes
Il devient avocat au parlement ce qui lui permet de plaider dans toute la Bretagne, dans toutes les juridictions, aussi bien de droit français que de droit canonique. Sans doute exerce-t-il aussi bien dans la Presqu’île de Rhuys qu’à Vannes. Toujours soucieux des paysans et de la misère qui les lient, il ne cesse de vouloir dénoncer le servage et la féodalité que les seigneurs exercent à leur encontre. Il se présente comme agriculteur et homme de loi. Il n’abandonne pas son domaine de Kerblay et prodigue même des conseils aux agriculteurs : utiliser la vase de mer comme engrais. Il a vu dans ses déplacements des nouvelles manières de préparer la terre, de l’entretenir et veut en faire bénéficier les paysans de Rhuys. Il veut valoriser la terre et préserver l’homme de trop grandes fatigues. Et sur son domaine, il inaugure l’élevage de 200 brebis qu’il vaccine contre une maladie, la clavelée. A Ploeren, il fait planter 400 pieds de mûriers blancs pour l’élevage du ver à soie. Hélas, il faut du soleil aux mûriers et la Bretagne n’en est pas bien pourvue, si bien que le rendement est loin de l’attente escomptée.
Il écrit :
« Il n’est point en France de province où la féodalité ait conservé plus longtemps sa barbare domination qu’en Bretagne. Cette domination a conservé la servitude ; la servitude a conservé l’abrutissement ; l’abrutissement, la misère et le défaut d’industrie. Toutes ces calamités sociales, soutenues par un idiome particulier, jettent sur une moitié de cette grande province l’empreinte de l’humiliation et de la détresse… »
Le désir d’une nouvelle forme d’agriculture, ne suffit pas à faire changer les choses et évoluer la situation du paysan de Sarzeau.
Aucun gentilhomme ne peut se faire une idée juste de ce mal qui provient de ce que ces privilèges leur sont départis tandis que le peuple n’a pour lui que la pauvreté. »
En 1791 où il est élu juge du tribunal pour le district de Vannes. Il manifeste une pugnacité, une obstination qui tend à vaincre l’adversaire, sans ne lui laisser aucune chance de se défiler.
La ville de Sarzeau ayant le statut de ville franche, elle a la possibilité d’élire un maire pour un mandat de 2 ans. Joseph Marie se présente et est élu les 3 juillet 1786. Il n’a pas les mains libres et est sous la tutelle de l’intendant de la province. II doit régler les conflits, trouver des solutions pour acheminer de manière plus régulière et plus sûre le courrier, secourir les indigents qui sont nombreux, rémunérer tel ou tel pour des travaux dans la ville, mais il doit en référer à chaque fois, alors qu’il est le premier élu de la ville. Il est en première ligne lorsque des embryons d’émeutes se produisent en juillet 1789. Le pays bouillonne.
En novembre 1789, il fait paraître son premier essai politique intitulé : « Les réformes et les économies ». Il y dénonce la dette de 3 milliards, les dépenses liées à la rémunération des régiments étrangers que la France emploie, les émigrés français qui quittent le pays et la nécessité de confisquer leurs biens, de faire élire par le peuple au suffrage direct les ecclésiastiques, évêques et prêtres, mais aussi d’élire ses députés, ses conseillers locaux. Il faut instruire le peuple en français sur tous les sujets et lui permettre de se former et de s’éduquer, de nommer dans les commandements militaires à égalité roturiers et nobles.
« Quelle éducation faut-il donc pour faire un héros (sinon) savoir être sobre, patient et courageux, avoir surtout bien appris à se soumettre à des ordres légitimes, ne commander qu’avec la loi, jamais par humeur, traiter les autres avec douceur, avec la fermeté faire toujours marcher la bonté dans son commandement et dans ses soldats, ne méconnaître jamais ses frères».
Député à la Législative
En 1780, puis en 1784, Joseph-Marie Le QUINIO est désigné par la communauté de ville de Rhuys comme député du Tiers aux États de Bretagne. Le 14 août 1786, il est reconduit dans ce rôle. De même en 1788. Mais avec les autres députés du Tiers de Bretagne, il refuse de voter une nouvelle loi sur les fouages et demande que le Tiers soit représenté à hauteur du clergé et de la noblesse réunie. L’intendant refuse et l’assemblée est dissoute. Elle reprend ses travaux en décembre, mais le peuple de Rennes est dans la rue pour soutenir ses députés. Des bagarres éclatent et un appel est lancé :
Un appel est lancé à toute la province :
« Bretons, voulez-vous vivre libre ou languir esclave ? 972 nobles ne sont pas faits pour asservir la Bretagne. »
Le 30 mars 1789, le cahier de doléance établit pour la sénéchaussée de Sarzeau est lu en assemblée. Il est riche de 75 articles. Il est demandé l’abolition des privilèges et des droits banaux des nobles, mais aussi des écoles pour instruire les enfants pauvres, des hôpitaux pour prendre en charge les malades, les vieillards incapables et les indigents. Une rémunération juste des curés qui sont eux aussi à la limite de l’indigence, ne recevant pas toujours le fruit des quêtes, quand elles sont autorisées par le recteur. Les orphelins occupent une place importante dans les doléances, une nécessité de les protéger dans des institutions.
Le 11 janvier 1790, il se retire de la vie publique pour redevenir cultivateur, car ses champs de mûriers demandent une grande attention, il a beaucoup investi dans cette culture et dans la vigne en son domaine de Kerblay. Il est persuadé que les doléances vont suivre leur cours et n’ont plus besoin de lui. Il insiste malgré tout sur la nécessité d’instruire le peuple et ses enfants en breton et en français. Il regrette que l’assemblée demande aux députés de payer un marc d’argent d’imposition pour avoir le droit d’être élu. C’est concentrer le pouvoir dans un petit nombre de mains puissantes par fortune. Il est élu juge au tribunal de Vannes.
En parallèle, il édite une feuille, à partir du 31 mars 1791, appelée le Journal des laboureurs. Il est très impliqué dans la vie des paysans et se sent lui-même agriculteur. Il incite le peuple à faire preuve de discernement dans le choix de leurs représentants et d’élire des hommes de confiance, honnêtes et de reconnaître les incapables et les intrigants.
Plusieurs soulèvements et agitations à Vannes et à Auray, le font sortir de sa tanière, de Kermurier. Il reprend du service, et le 1er septembre 1791 il est élu député à l’assemblée nationale qui prend le nom de législative. Il part pour Paris, et loge rue des Grands Augustin.
Député montagnard à la Convention
Dans le dernier trimestre de 1791, de nombreuses lois sur le système religieux occasionnent des troubles dans la population du Morbihan, Vendée, Deux-Sèvres et Loire-Atlantique. Les pétitions d’un grand nombre de citoyens, ne change rien à la décision de l’assemblée : tous les prêtres doivent adhérer au serment civique. C’est un texte encore plus dur que celui proposé par Le QUINIO qui est voté. Il décide d’écrire une lettre au peuple des campagnes, L’Adresse, qu’il lit à la tribune du Club des Jacobins. Elle est approuvée, publiée et distribuée. C’est dorénavant un orateur écouté. Il respecte le bas clergé, d’autant plus que sa famille compte plusieurs prêtres. Par contre il peste contre les émigrés qui ont fui la France avec un numéraire considérable abandonnant leur pays par intérêt personnel. Il suspecte à juste raison le ministre de la marine, le comte de Molleville, d’organisé la fuite des officiers de la Royale, la marine de guerre française. En août 1792, le ministre s’enfuit lui aussi en Angleterre.
Joseph Marie se porte candidat pour intégrer les commissions de l’agriculture et de l’instruction, les deux étant pour lui complémentaire. Il songe au démembrement total du système féodal, ayant toujours à l’esprit la condition miséreuse des paysans de Sarzeau. Il s’intéresse plus particulièrement aux canaux, moulins et machines hydrauliques persuadé que de nouvelles techniques vont soulager la peine des travailleurs et facilité le négoce pour le bien du pays. Il facilite l’approbation par l’assemblée, de l’édification du canal Rhin-Rhône. De nombreux autres projets du même type lui sont proposés, mais les finances manquent. Son projet d’un canal reliant Saint-Malo, Redon et Rennes à l’océan, par la Vilaine, l’Isle et la Rance est rejeté. C’est la navigation intérieure et l’essor économique de sa province natale, qu’on lui refuse. C’est pour lui faire perdurer « les horreurs de la disette ».
Il écrit, dans cette alliance toujours présente chez lui de la conviction et de l’intérêt général :
« Combien de départements dans la France, par exemple, où les vins et les bois sont à vils prix ! Leurs habitants demeurent toujours pauvres et malheureux au sein de cette abondance de deux objets de nécessité première qu’ils feraient, par des canaux, avantageusement parvenir aux extrémités de la République où l’on en a le plus besoin, et en semant sur leur route l’aisance avec le mouvement. L’intérêt général, ne doit-il pas avoir la priorité sur tous les autres ».
Il parvient aussi à faire supprimer le domaine congéable, instrument de la servitude paysanne. Il vote la guerre contre la Hongrie, « tactique qui consiste à massacrer des peuplades entières » écrit-il pourtant.
Le 7 novembre, Le QUINIO dépose à la Convention l'opuscule Les préjugés détruits dans lequel il défend notamment l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'agit de l'un des rares députés de la Convention, avec Pierre Guyomar et Gilbert Romme, à abonder en ce sens. Le 1er décembre, il dépose l'opuscule Richesse de l'Etat ou de la navigation intérieur.
Le QUINIO siège sur les bancs de la Montagne. Lors du procès de Louis XVI, il vote la mort sans appel au peuple ni sursis à l'exécution.
Début d’année 1793, il est envoyé en mission aux frontières du Nord pour inspecter les fortifications et les remettre en état si besoin. Il s’acquitte de sa mission avec succès. Mais à l’été, des places fortes tombent, Valenciennes, Mayence, Toulon. La guerre et les insurrections font rages en Vendée et en Charente.
Une nouvelle mission l’envoie en septembre à La Rochelle. La colère de la population en proie à la disette, monte dans toute la ville. 5 familles s’en partagent toute la fortune. Il recrute de nouveaux administrateurs et fonctionnaires pour assurer l’approvisionnement, juguler les émeutes et assurer la victoire militaire en Vendée. Une mutinerie pour réclamer de la nourriture, éclate dans la prison de la ville et Le QUINIO lui-même brûle la cervelle d’un des meneurs. Il oblige les contribuables les plus fortunés à renforcer l’approvisionnement de l’hôpital en lits et matériels nécessaires au soin des blessés et malades, ainsi que l’approvisionnement de denrées alimentaires. Il fait de même à Rochefort. Les malversations et les mutineries sont réprimées durement. Il fait acheminer du bois des environs de Tours pour faire construire de nouveaux navires et les équiper de canons.
Joseph Marie Le QUINIO déploie une grande activité pour subvenir aux besoins de la population et des militaires. Il met en place de nouvelles équipes de fonctionnaire après avoir épurées les précédentes.
Mais il trouve les nouvelles instances judiciaires trop clémentes, il les incite à plus de sévérité, ce qu’elles font dans un premier temps. Puis, comme nombre de suspects emprisonnés sont malades, sur 581 jugements, 60 condamnations à mort sont prononcées. Plus tard Le QUINIO dira qu’il a fait le nécessaire pour que prêtres, bourgeois, nobles, contrebandiers et déserteurs soient condamnés. La petite paysannerie est épargnée.
Cependant, lorsque des navires se présentent dans les ports, les officiers sont arrêtés, jugés pour avoir conspiré contre la république et 12 sont exécutés, peine pour l’exemplarité. A certains moments il a mis son veto contre la condamnation d’autres prévenus, estimant qu’ils s’étaient rachetés par des actions en faveur de la république.
En janvier 1794, il est relevé de ses fonctions par ordre du Comité de Salut Public qui se ravise et l’envoie enquêter en Vendée.
La disgrâce de l’homme politique
L’Assemblée continue son travail législatif, et décrète :
« Sera établi dans dix jours à compter du jour du présent décret, un instituteur de langue française dans chaque commune de campagne des départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes du Nord et dans la partie de la Loire Inférieure dont les habitants parlent l’idiome appelé bas breton »
De passage à Vannes en mars 1794, Joseph Le QUINIO contraint la population à assister à ses prêches athées. Il s’oppose à Robespierre sur la question de l‘Être suprême dans son ouvrage Les préjugés détruits, certains biographes ont interprété le rappel de Le QUINIO comme une disgrâce de Robespierre. Cependant, en mai 1794, au nom de la liberté de conscience, l'incorruptible prend sa défense au club des jacobins, quand Jacques Brival attaque ses idées athées professées dans les préjugés détruits.
Le 1er avril 1794, Le QUINIO présente un rapport devant le Comité de salut public sur la situation en Vendée. Il juge indispensable de faire exécuter les prisonniers de guerre vendéens pris les armes à la main, et souhaite même que cette mesure soit également appliquée aux soldats de la coalition, cependant, il estime que la population de la Vendée est encore trop nombreuse pour être exterminée, il désapprouve finalement les massacres des civils et accuse les militaires de profiter de la guerre pour s'enrichir par le pillage au lieu de combattre les rebelles, notamment Thureau, le général en chef. Dans son rapport il écrit :
« Les ordres barbares du scélérat Huché, général à Luçon […], envoyé par le général en chef Turreau pour incendier, massacrer tel pays duquel il ne connut jamais ni les principes des habitants ni la position territoriale ». « Les généraux de cette armée, dès les premiers instants, ont fait de cette guerre un objet de spéculation et d’intérêts particuliers ».
« Les délits ne se sont pas bornés au pillage ; le viol et la barbarie la plus outrée se sont représentés dans tous les coins. On a vu les militaires républicains violer des femmes rebelles sur les pierres amoncelées le long des grandes routes et les fusiller ou les poignarder en sortant de leurs bras. »
Il souligne que toutes ses exactions, ont jeté le peuple de Vendée dans les bras des rebelles pour grossir leurs rangs et prolonger cette guerre. Il propose une amnistie pour les vendéens qui ont été conduit à la révolte, par leurs nobles et/ou prêtres mais qui n’ont pas d’intérêt personnel à poursuivre les combats. Il propose une instruction publique de la population et l’organisation de fêtes pour distraire le peuple des malheurs que cette guerre leur a occasionné.
Les exactions continuent : fusillades de femmes et d’enfants, viols, commis par la troupe du capitaine Goy-Martinière. La commission militaire établie par Le QUINIO, condamne à mort le capitaine, mais le Comité Public dissout la commission et Goy-Martinière est sauvé.
Le QUINIO quitte Fontenay-Le-Peuple (Fontenay-le-Comte) et laisse un souvenir plutôt favorable.
« Il fit révoquer l’ordre que le général Turreau avait donné à Huchet d’incendier une étendue de quarante communes ». c’est Le QUINIO qui, après avoir dit dans tous les temps que ces mesures incendiaires n’étaient propres qu’à prolonger la guerre désastreuse qui nous dévorait, a sauvé des flammes, du pillage, de la dévastation et de la mort la nombreuse population de ces quarante communes et les propriétés qu’elles renferment… »
Après le 9-Thermidor (27 juillet 1794), Joseph Le QUINIO tente de s’assurer le contrôle du Club des Jacobins, puis, ayant échoué, propose d’interdire aux députés de fréquenter des sociétés populaires. Il propose que les cendres du grand Jean-Jacques Rousseau soient translatées au Panthéon. Une majorité de députés tranchent en faveur de sa proposition. Les épurations de la Terreur ne lui permettent pas de retrouver le crédit qu’il avait avant de partir en mission, et il n’est plus écouté par l’assemblée.
Conscient que sa place de député peut-être à tout moment remise en question, Joseph Marie Le QUINIO, assure ses arrières par l’achat de plusieurs biens sur la commune de Sarzeau.
« Il se rend propriétaire d’un pré dépendant de l’hôpital de Sarzeau appartenant jadis aux Trinitaires pour la somme de 6 800 livres et d’un terrain au lieu-dit « Les Vignes du Net » non loin de son domaine de Kerblay, bien de l’émigré Francheville-Pellinec pour 2 525 livres. Enfin, le 20 messidor (20 juin 1794), il avait acquis une métairie au lieu-dit Kerlain, bien de l’émigré Gouvello Kyaid pour 25 900 livres. À ce capital foncier assez conséquent, il faut ajouter les deux moulins acquis dans le district de Surzur. »
D’où proviennent tous ses fonds ? Le QUINIO n’a rien volé. Ce n’est que son salaire de député et les subsides qu’il a reçu pour les différentes missions qu’il a effectué pour le compte du Comité de Salut Public.
« Il a perçu une indemnité mensuelle de 540 livres, comme chacun de ses collègues, soit un total d’environ 30 000 livres auxquelles s’ajoutent des avances pour frais de mission : 12 825 livres pour celles auprès des frontières du Nord puis de l’armée du Nord ; deux fois 2 000 livres pour celles dans l’Aisne et l’Oise en août 1793 ; 12 000 livres le 14 septembre pour celles dans les ports de La Rochelle et Rochefort ; enfin 403 livres et 350 livres respectivement les 13 floréal et 17 prairial pour solde de tout compte. »
Preuve s’il en est de la personnalité controversée de Le QUINIO, cette lettre pleine de compliments que lui adresse le 13 novembre 1794 Marie-Bonne Rivière de la Souchère, en pleine détresse, il est vrai : "Citoyen représentant, Toi, qui aime tant faire le bien, et dont toutes les actions annoncent la bonté, la justice et l'humanité, etc."
Il se débat en tous sens à l’assemblée, conscient du faisceau de ressentiments dont il est l’objet de la part de nombreux députés montagnards. Pour lui :
« La Révolution est à son terme. Où pourrions-nous donc aller encore ? Quels pas aurions-nous encore à faire en avant qui ne tendraient qu’à nous plonger dans le précipice ? »
Il semble accepter l’inégalité sociale comme un mal nécessaire. Pourquoi changer d’opinion par rapport à ce qu’il prétendait précédemment ? Il est devenu propriétaire terrien. L’égalité sociale le gênerait-elle ou pense-t-il qu’un durcissement des mesures déjà prises, c’est prendre le risque de mettre en péril ce qui a été acquis jusque-là ?
Il témoigne contre Carrier et note les atrocités qu’il a commises à Nantes. Ce dernier est condamné et exécuté le 16 décembre 1794. Il est chargé de l’approvisionnement de Paris. L’hiver est si rigoureux que la Seine gèle.
« Le froid extrême tue les pauvres dans les rues et les mansardes de Rouen, de Dieppe, du Havre, de Lisieux et de Paris, enterrant dans les tourments de neige ceux qui cherchaient à manger. »
.Dénoncé par les nouveaux maîtres de Rochefort pour exactions et rapines il est accusé de toutes les horreurs possibles, avec de faux témoignages et de faux documents. La fatigue, le découragement, le sentiment d’avoir échoué au regard des principes et des idées qui l’avaient poussé dans la vie politique, ont affaibli son énergie intellectuelle. Il peine à se défendre. Il est accusé, arrêté et conduit à la Grande Force. A l’abri de la société, il retrouve des forces intellectuelles et se remet à écrire, un livre qu’il croit être le dernier : Philosophie du peuple ou éléments de philosophie et de morale mis à la portée des habitants des campagnes.
« Un des malheurs de la Révolution c’est qu’une grande partie du peuple n’est pas instruit » et surtout qu’« il n’a point d’idée du gouvernement et moins encore du gouvernement républicain… »
« Depuis que la République est formée en France, nous ne sommes pas plus heureux qu’auparavant. Nous avons été même plus malheureux, la République n’était pas du tout aimable. Je crois qu’il vaudrait autant vivre sous un roi que sous le gouvernement républicain pour voir les échafauds, les prisons et la persécution partout »…
L’amnistie votée par la Convention le 26 octobre 1795, le laisse sans siège à la Convention et sans revenus. Il erre dans Paris de domicile en domicile et la police le suit à la trace. Les chouans ont réquisitionné ses domaines à Sarzeau, et il ne peut donc s’y rendre. Il est obligé de demander un secours. Son élection au Conseil des Cinq-Cents dans le département du Nord en 1798 est annulée et il vit de son salaire d’inspecteur forestier à Valenciennes. Il entreprend de voyager dans le Jura, et il décrit tout ce qu’il voit, entend, et observe. De retour à Paris, il est surveillé par la police de Fouché,
A la suite du coup d’état du 18 brumaire, il écrit au frère de Bonaparte, Lucien, promu ministre de l’intérieur, pour obtenir un poste de préfet, voire de bibliothécaire. On l’ignore. Il est devenu invisible aux yeux du nouveau pouvoir. Pendant 6 ans, Joseph Marie, erre dans Paris sans ressources et presque sans toit. Courant décembre 1801, il est avisé qu’un poste lui est attribué.
« Article 1 : Le citoyen Le QUINIO est nommé Sous-commissaire des relations commerciales à Newport États-Unis.
Dans l’état de dénuement où il se trouve, il n’a guère d’autre choix que d’accepter cette providentielle offre d’emploi.
L’exil aux Etats-Unis
C’est le navire La Marie qui vient accoster dans le port de Nantes, qui le fait quitter sa Bretagne natale. Après 37 jours de mer, il pose le pied sur le sol des États-Unis d’Amérique, à Philadelphie. Son arrivée est annoncée par la presse locale.
Joseph-Marie LeQUINIO n’est pas un inconnu sur le Nouveau continent. Avant d’y prendre pied, son nom circulait déjà, principalement dans le milieu des hommes de lettres et aussi dans le monde politique, chez les démocrates en particulier, grâce à son œuvre majeure, Préjugés détruits, que Thomas Paine avait traduite et qu’il recommandait chaleureusement à son propre lectorat.
« M. LeQUINIO dédie cette œuvre extraordinaire non pas à une nation en particulier, mais à l’univers tout entier : il appartient aux générations futures d’anéantir les préjugés du présent et de conquérir leur bonheur et leur liberté. »
Ami de Thomas Paine, Joseph-Marie Le QUINIO paraît l’avoir été aussi de Thomas Jefferson, alors qu’il était ambassadeur des États-Unis en France au cours de la période révolutionnaire. Il essaie de s’introduire auprès de la bourgeoisie américaine mais sans succès. Il n’écrit plus et attend les instructions d’un ministre qui semble l’avoir oublié. Il apprend que le commissaire des relations commerciales de Baltimore, Levillain, vient de mourir, il se propose pour le poste. En vain. Il use de subterfuge pour se faire nommer à Savannah. Il demande la confirmation de sa mutation. Elle lui est refusée, il doit rester à son poste de Newport, où il a été nommé. Maintenant, convaincu d’avoir été exilé, il quitte son poste sans prévenir sa hiérarchie, et s’éclipse.
Viticulteur dans l’État de Caroline du Sud
Il semble connaître l’Amérique, car il en a fait l’éloge dans l’un de ses ouvrages.
« Peuple vaillant et laborieux, qui habite cette terre de liberté (et qui) gémissait sous la tyrannie du roi d’Angleterre » qu’il a vaincu. « Imitez donc les américains »
Le 24 février 1802, 3 semaines avant son départ, il a épousé Jeanne-Odette de Lévis Mirepoix, 36 ans, fille d’un émigré qui s’est fixé à Rome en juillet 1789. C’est une très vieille famille de la noblesse française, et ils sont partis avec 500 000 livres en or et en argent.
Dans le contrat de mariage établi par le notaire Pérignon, l’ex-conventionnel apparaît sous le titre de « commissaire aux relations commerciales à Newport », à l’évidence plus gratifiant que celui de « sous-commissaire ». Il se déclare en outre propriétaire de « diverses métairies et autres immeubles situés dans les communes de Sarzeau, Saint-Gildas de Rhuis, Plairain et Plougommelen, département du Morbihan ».
S’y ajoutent
« Quinze cents acres de terre, mesure des États-Unis, à prendre en telle partie dont il a le choix dans une pièce de terre de seize mille acres située sur Spring Break et Reddy Creek, état de Virginie ».
Jeanne Odette apporte comme dot
« Le vignoble de Saint Haon, consistant en bâtiments et autres dépendances situés au bourg de Saint Haon, canton d’Ambraes, département de la Loire, en jardins et différentes pièces de vignobles et prés, situés dans la même commune de Saint Haon et contenant ensemble 4 hectares 30 ares environ et une rente de 16 mesures de seigle due sur un étang appelé d’Apreuve en la commune de Saint-Martin ». Et du partage de la succession de ses père et mère d’un capital de 149 631 livres.
Il achète au cours des années qui suivirent sa liberté retrouvée, 777 hectares de terre pour 26 250 francs. Pour défricher la terre acquise et la préparer à la plantation de vignes, Le QUINIO de Kerblay emploie plusieurs esclaves, puisque c’est la norme à cette époque en Virginie. Il semble toutefois qu’il se soit attaché à conserver leur vie familiale. Il devient citoyen américain le 1er novembre 1807.
. A aucun moment il ne participe à la vie politique américaine. Il se consacre à son unique projet :
« Introduire aux États-Unis un choix de grappes de raisins, planter un vignoble qui puisse produire un vin de qualité égale à celui qui est fabriqué en Europe. Ce gigantesque projet qui a jusqu’à présent effrayé tous ceux qui l’ont tenté, en raison de la nécessité d’associer un gros investissement qui exige du talent et de la fortune, ce fut l’activité exemplaire de M. LeQUINIO et toute sa vie fut le témoin du succès de cette industrie… »
Il envisage une exportation vers le vieux continent. Mais le 20 août 1812, Joseph-Marie Le QUINIO est retrouvé sans vie dans sa ferme de Liberty III. Il entrait dans sa 57è année. Son lieu de sépulture est inconnu. Il meure sans postérité. Il laisse une bonne image de lui.
« Comme personne privée, comme citoyen des États-Unis et comme voisin, le caractère de M. Kerblay était vraiment très estimable. Son aspect extérieur comme l’apparence de sa personne étaient rudes, mais son esprit était énergie et élégance […]. Sa conversation était riche, copieuse et invariablement instructive […]. Il avait un tempérament assez enthousiaste […], une ardeur et une délicatesse de perception associées à une grande sensibilité […]. M. Kerblay était toujours fortement attaché à la connaissance des sciences, particulièrement les sciences naturelles… »
Une controverse existe sur la date de sa mort. Des historiens ont affirmé qu'il serait revenu en France et serait mort à Sarzeau le 19 novembre 1814. En réalité, les archives départementales du Morbihan25 indiquent qu'une petite Marie-Joseph QUINIO de cinq semaines est morte ce jour-là. Il a sans doute été confondu avec cette dernière.
Sa femme est morte le 2 novembre 1822 et est enterrée à Augusta dans le cimetière Les Magnolias.
Lors de l’inventaire fait au décès de Joseph-Marie Le QUINIO de Kerblay on note :
« Inventaire
vrai et parfait du cheptel et du personnel de la succession de Le
QUINIO Kerblay de Edgefied par Christian Breithaup, administrateur le
1er juin
1808 ». Les estimations sont donnés par Christian
Breithaup :
Claude
et sa femme Louisa : 525 $
Wophodie,
sa femme Gala et leurs enfants Félix, Fanny et Polly 1 100 $
Toco,
sa femme Siger et leur fils Fortinato : 900 $
Calin,
sa femme Timp et leurs enfants Fobe et Lewis : 900 $
Tor,
sa femme Semblay et leur enfant William : 900 $
Cally
et sa femme Clara : 600 $
Fanar,
sa femme Pompain et leur fille Sophia : 1 000 $
Macosa,
sa femme Hombe et leurs enfants Robert et Dnembey :
1 000 $
Tom :
450 $
Body :
450 $
Grandsey :
450 $
Mandoc :
450 $
Ligatte
et ses enfants Melany, Charles, Lewis et James : 1 125 $
Joffrey
et sa femme Thankye et leurs enfants Paul et Bigeote :
1 000 $.
Neuf
autres esclaves étaient employés par Le QUINIO sur son domaine,
mais s’évadèrent à la faveur de son décès. Ils ont pu être
identifiés en la personne de Pery, Mamoda, Jacky, Cambasse, Missely,
Baccho, Boy, Jambo et Watschey
M.A. Boucard
Pour en savoir plus : de Claudy Valin : Le QUINIO, la loi et le salut public aux presses universitaires de Rennes
« Le 18 août 1790, obligée de quitter le couvent à la Révolution, Jeanne Odette de Lévis Mirepoix se maria à M. de LeQUINIO-Kerblay » ! rapportent Félix Pasquier et Siméon Olive dans l’Inventaire historique et généalogique des documents de la branche Lévis-Léran, devenue Lévis-Mirepoix.

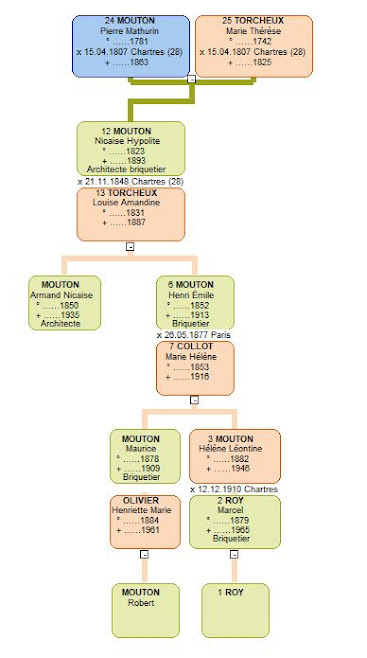

Commentaires
Enregistrer un commentaire