M comme attention, voilà les Moustaches!
Les gendarmes étaient appelés ainsi, en référence à leur moustache dont le port était obligatoire à partir du XIXe siècle. Moustache à la française pour ces derniers, cirée, maîtrisée, en chevron, en fer à cheval, à l’impériale, à l’anglaise, etc., si Maupassant la portait à la morse, Hiltler la préférait en brosse à dents : petite moustache grand dictateur! Une généalogie sans moustachus ou barbus est impossible à imaginer. Au cours du temps, la moustache a en quelque sorte tiré le portrait de nos aïeux, difficile d’imaginer un Gaulois, un portrait de Louis XIV, Molière ou Napoléon III ou de notre arrière grand-père sans cet attribut.
L’attribut obligatoire pour les militaires
En 1832 la moustache est imposée à tous les militaires puis interdite en 1836 pour les gendarmes et à nouveau obligatoire en 1841, mais la mouche reste interdite. L’instruction du 21 avril 1846 indique qu’elle doit être taillée en brosse.
En 1848 à l’image de l’empereur Louis Napoléon Bonaparte, elle doit être accompagnée de la mouche. En 1858 ses dimensions sont précisées : elles doivent faire toute la longueur de la lèvre. Facultative en 1886, elle redevient obligatoire en 1914 avec ou sans la mouche pour tous les militaires. L’usage de gaz toxiques commence dès 1914 par les français. Le 22 avril 1915 l’Allemagne, lors de la bataille d’Ypres les utilise de façon massive.
Le 26 septembre 1916, les poilus obtiennent le droit de raser leurs moustaches. Beaucoup avaient d’ailleurs devancé le décret, car la moustache et le port du masque à gaz étaient incompatibles. La moustache représentant un obstacle à l’adhérence du masque pour remplir son rôle de protection contre les gaz toxiques.
Après la Première Guerre mondiale, la moustache commence à disparaître chez les gendarmes. Ils la portent étroite durant l’entre deux guerre, le règlement de 1933 entérine cette situation et rend la moustache facultative. Un décret du 1er octobre 1966 repris dans le règlement des armées en 1971 limite cependant le port de la barbe soumise aux exigences de l’hygiène et de la sécurité (masques et équipements spéciaux).
récapitulatif des obligations relatives à la moustache |
La moustache, marqueur d'identité
Maupassant à travers le personnage de Jeanne décrit les différents types de moustaches dont "celles pointues, aiguës comme des aiguilles qui sont liée aux hommes qui préfèrent le vin, les chevaux et les batailles et considère la moustache comme un attribut typiquement français remontant aux Gaulois et symbolisant le caractère national". La nouvelle se termine sur une note sombre, Jeanne reconnaissant les soldats français morts à leurs moustaches lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Cette nouvelle est une réflexion et un éloge de Maupassant sur l’identité masculine et nationale française de l’époque où la moustache est chargée d’un fort pouvoir symbolique.
La moustache, marqueur social
Plus près de nous, c’est à cause de cet attribut, marqueur d’autorité, voire de rang social que les garçons de café se mirent en grève pour réclamer un jour de congé et le droit de porter la moustache. Nous étions en 1907, ils obtinrent gain de cause. Ainsi ceux qui se nommaient "garçons" à cause de leurs visages glabres accédaient à un privilège réservé jusque là aux classes sociales aisées et aux militaires.
Une vaisselle destinée aux moustachus
Dans les foyers bourgeois, il existait des ustensiles dédiés aux hommes moustachus et soignés qui ne voulaient pas salir leurs vêtements : tasse à moustache, cuillère à moustache, verres. Vous avez peut-être aperçu dans le grenier ou des vide-greniers ces objets dont personne ne pouvait dire l’usage sauf les brocanteurs et antiquaires.
Innovation anglaise, la tasse à moustache facilite le quotidien des moustachus à l’heure de prendre le thé sans faire fondre la cire qui permettait à la moustache de se maintenir droite. Cette invention des années 1860 par le potier Harvey Adams répondait à une demande, car de 1860 à 1916 l’armée anglaise exigeait aussi la moustache pour ses soldats.
Cette tasse resta à la mode jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Entre 1920 et 1930, la moustache se démode et la production de ces objets périclite.


Des dispositifs, tel que le mousclier protège moustache, sont encore utilisés de nos jours.


Autre ustensile qui finira par disparaître la cuillère à moustache inventée aux États-Unis en 1863.

La moustache et les codes esthétiques

Trombinoscope de congressistes au début du siècle, on remarque la variété des formes de moustache.
Les codes esthétiques ont évolué en fonction des époques. Pasteur (1822-1895) avec la découverte des germes a contribué à mettre fin à l’engouement des hommes pour la moustache, car selon une étude d’époque on y trouvait toute sorte de bactéries, cependant le grand homme a porté barbe et moustache comme ses contemporains parce que c’était la mode ou l’usage de son époque.
La moustache va-t’en guerre
En 1915 sous, l’impulsion de Justin Godart, ministre de la Santé et fondateur de la ligue contre le cancer, alerte sur l’état sanitaire dans les tranchées et fait réagir les plus hautes autorités militaires qui décrète l’aménagement de salles de bains dans les tranchées afin d’assurer un minimum d’hygiène et de prophylaxie dont l’entretien des pilosités faisait partie.
Le code capillaire des soldats était sous contrôle étatique, entretenir une moustache et une barbe dans les tranchées de la Grande Guerre était problématique, car les miroirs brisés ne facilitaient pas la tâche. La corvée de rasage était organisée collectivement, un poilu étant désigné pour raser les autres, instituant un suivi de propreté et de soins d’entretien.

Dans la revue Historia du 1er novembre 2001, on trouve l’origine du terme poilu. Dès le XVIIIe siècle, Molière parle de "brave à trois poils" expression désignant, un individu d’une bravoure exceptionnelle. Plus tard, dans le langage familier, le terme "poilu" désignait un homme fort et courageux. Avoir du poil au menton pour ne pas parler d’autres parties du corps est un symbole de virilité. Le Poilu est l’héritier du grognard napoléonien soldat courageux, faisant face aux mauvaises conditions de vie aussi bien qu’à l’ennemi.
Moustaches célèbres

Molière

Guy de Maupassant

Gil
Blas
Moustaches très célèbres

Celle du gendarme, à la française début XIXe
Celles de soldats de la Première Guerre.


Celle de Dali (1904-1989).
La moustache à la loupe
L’historien Jean-Marie Legall, dans son ouvrage, dont le titre est : "Un idéal masculin? Moustaches et barbes du XIVe au XVIIIe siècle" considère la pilosité faciale en tant que marqueur significatif de l’identité masculine et en fait un sujet d’étude.
Un autre historien Alun Withey (Exeter Université) en 2021 dans une étude affirme que "la barbe et les moustaches refont leur apparition lorsque les questions de genre ou de masculinité sont débattues". Il suggère que le retour récent de la barbe pourrait refléter les débats actuels sur les concepts de genre et de corps.
Le mouvement November dont le logo est une moustache bleue est né en 1999 afin de sensibiliser les hommes à leur santé physique et mentale. Initié en Australie, il s’est répandu dans le monde. Le port de la moustache étant de retour, c’est en 2012 que l’option barbier est rétablie au brevet professionnel en France.
Si la moustache en tant que marqueur représentatif de la masculinité a fait l’objet d’études et de publications d’ouvrages d’historiens, c’est que cet attribut fait partie de l’Histoire et intéresse tous les curieux , passionnés, amateurs , tous les publics attachés à la petite et grande Histoire.
Elisabeth COUSIN Robert NIZAN

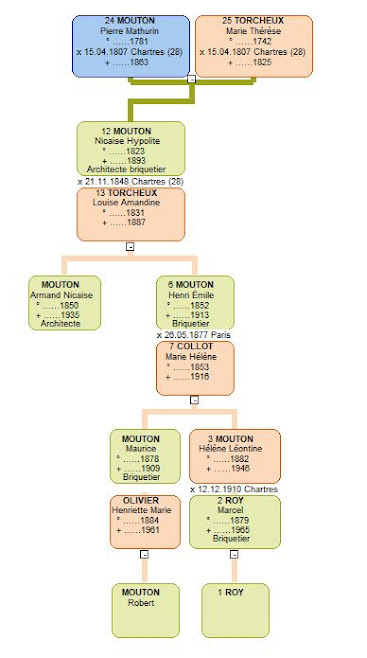

Commentaires
Enregistrer un commentaire