F comme FRETEVAL et LES ARCHIVES DE FRANCE :
FRETEVAL, petite ville du Perche située à une quinzaine de kilomètres de Vendôme, au nord du département du Loir et Cher, dans la vallée du Loir, a joué un grand rôle dans les guerres ayant opposé Anglais et Français entre les 11èmeet 15èmesiècles.
La bataille ayant vu s’affronter deux grands rois à Fréteval en 1194, reste un moment fondateur de l’histoire des archives en France.
RAPPEL HISTORIQUE :
Même si l’on évoque toujours la guerre de 100 ans, c’est en réalité pendant 400 ans que des guerres ont opposé les royaumes de France et d’Angleterre.
Après avoir été cédée aux Vikings en 911 par le roi des Francs Charles III dit « le Simple » (879-929), et grâce à l’expansion du commerce maritime entre Rouen et l’actuelle Scandinavie, la Normandie, dont le nom signifie « terre des hommes du nord », devint dès le 10ème siècle la province la plus puissante et la mieux administrée d’Europe.
La Cour d’Angleterre ne manqua pas de s’unir à cette province pour mieux régner sur le vieux continent.
En 1064, sans descendance directe, le roi Anglais Edouard le Confesseur proposa le trône à son cousin Guillaume (1027-1087), 7ème duc de Normandie, qui s’empressa d’accepter. Mais à la mort d’Edouard en 1066, Harold fils du comte de Wessex, prit le pouvoir.
Le 14 Octobre 1066, le duc normand Guillaume débarqua sur le sol anglais et à la célèbre bataille de Hastings, les troupes normandes balayèrent l’armée anglo-saxonne d’Harold qui mourut au combat.
Couronné roi d’Angleterre dans l’Abbaye de Westminster, Guillaume le Conquérant scella le destin de son duché à celui de la couronne d’Angleterre.
Après la mort de Guillaume le Conquérant, ses successeurs conservèrent leur titre de duc de Normandie et perpétuèrent un âge d’or entamé au siècle précédent.
Ce succès était perçu avec envie dans le royaume de France. Les premiers rois capétiens, notamment Philippe 1er (1060-1108) se trouvaient dans l’ombre du royaume anglo-normand.
Mais les choses ont changé avec la longue crise successorale du trône d’Angleterre qui vit arriver au pouvoir, en 1154, le roi Henri II Plantagenêt. Celui-ci n’avait qu’une idée en tête : gouverner son royaume d’une main de fer et surtout dépecer la France capétienne.
Devenu en 1151 comte d’Anjou et du Maine par ses liens familiaux, il avait également obtenu le titre de duc d’Aquitaine par son mariage en 1152 avec Aliénor d’Aquitaine.
Son successeur et fils, Richard Cœur de Lion (1157-1199), contribua à vider les caisses du royaume et le coup de grâce vint de Jean Sans Terre (1166-1216), 3ème roi Plantagenêt qui fit subir à son peuple une lourde politique fiscale créant un sentiment d’animosité envers la dynastie des Plantagenêt.
Pendant ce temps, qu’en était-il du royaume de France ?
Par sa vision politique plus entreprenante que celle de ses prédécesseurs, Philippe-Auguste (1165-1223), roi ambitieux et visionnaire, n’avait jamais accepté l’erreur carolingienne d’avoir cédé la Normandie aux Vikings. Il considérait le duc de Normandie, donc le roi d’Angleterre, comme un vassal régnant sur son fief.
Il avait un objectif essentiel : récupérer la Normandie, et pour ce faire, il favorisa l’accession au trône d’Angleterre du manipulable Jean Sans Terre qui le laissa pénétrer en Normandie en avril 1193.
Philippe-Auguste s’empara alors de plusieurs places fortes et en janvier 1194, Jean Sans Terre lui céda la vallée de la Seine à l’exception de Rouen.
C’est le 6 Mars 1204 que Philippe-Auguste parvint à faire sauter le verrou de Château-Gaillard sur la Seine, pour s’emparer de la capitale normande et achever la conquête du duché.
Mais, les guerres entre Anglais et Français n’étaient pas terminées pour autant, tant s’en faut.
L’AFFRONTEMENT ENTRE PHILIPPE-AUGUSTE et RICHARD-CŒUR-DE-LION :
Au printemps 1194, après avoir repris Evreux sur les Anglais, qui s’en étaient emparés par la trahison, Philippe-Auguste, à la tête de son armée, se dirigea sur la Touraine, résolu de venger l’outrage que Richard Cœur de Lion venait de faire à Saint Martin en pillant son église de Tours.
Le 5 Juillet 1194, il se trouva contraint de lever le siège de la forteresse de Vendôme car les troupes de Richard Cœur de Lion étaient à ses trousses.
Pensant avoir laissé l’anglais à Vendôme, Philippe Auguste se retrouva alors pris dans une embuscade sur un chemin étroit entouré de marécages, dans les environs de Fréteval.
A Fréteval, à une quinzaine de kilomètres de Vendôme, se trouvait une forteresse construite par Nivelon 1er, sénéchal du comte de Blois, située à la limite des comtés de Vendôme et de Blois, tenue par les Anglais entre 1158 et 1194 (il ne reste que les ruines du donjon).
C’est là que les 2 camps s’affrontèrent.
La bataille de Fréteval n’a pas été fatale au roi de France. Mais cette défaite chaotique aura des conséquences historiques insoupçonnées.
Le chapelain de Philippe-Auguste, Guillaume le Breton, raconte la scène dans « la Philippide » (biographie rédigée en latin entre 1214 et 1224 dans laquelle, à la demande du roi, il réécrit l’histoire de son règne en passant sous silence de nombreux faits ternissant son image de roi vertueux) :
« Tout à coup, le roi des Anglais s’élance du sein de sa retraite et disperse facilement ce peuple désarmé et tout chargé de vivres et d’effets : il tue, emmène, enlève les chariots, les bagages, les chevaux, les corbeilles et les vases des cuisines et des tables, vases que l’or et l’argent rendaient éclatants et plus précieux que tous les autres. Le ravisseur n’épargna pas davantage les petits tonneaux tout remplis d’écus, non plus que les sacs qui renfermaient les ornements, les registres des impôts et effets ; et le roi éprouva une perte si considérable en ce lieu, que l’on pourrait croire que ce village avait réellement reçu son nom de la guerre et de la fraude ».
Philippe-Auguste perdit non seulement ses équipages, le sceau royal, le trésor et les registres du fisc, qu’il transportait dans ses campagnes militaires, mais encore toutes les lettres par lesquelles les habitants de la Normandie se reconnaissaient ses vassaux en vertu du traité conclu en janvier 1194 entre lui et Jean Sans Terre.
Cette défaite cuisante fut terrible pour le roi de France qui a alors été contraint de reconstituer ses chartes domaniales, les registres et archives particulières de la couronne royale.
LE TRESOR DES CHARTES :
Il s’agit du fonds le plus ancien des archives royales conservé par les Archives Nationales françaises. Il constitue le fondement des futures archives du royaume que la Révolution Française viendra nationaliser en 1794.
Ce serait à la défaite de juillet 1194 à Fréteval que remonterait l’établissement du Trésor des Chartes : Philippe-Auguste ayant alors décidé de ne plus se déplacer avec ses documents officiels et de les conserver dans un endroit sûr.
C’est du moins ce que rapporte une constante tradition que la plupart des auteurs modernes ont accepté d’autant qu’elle n’est pas contredite par les chroniqueurs du temps ni par les évènements postérieurs.
Rien ne permet de fixer d’une manière précise l’époque à laquelle remonte la création d’un dépôt des registres et archives particulières de la couronne royale, mais il est certain que la nécessité de cette création naquit à la suite de la défaite de 1194.
A la suite de la bataille de Fréteval, Philippe-Auguste était accompagné de deux hommes de grand mérite :
Guérin, frère profès de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui devint ensuite évêque de Senlis, qui exerça longtemps les fonctions de garde des sceaux sous Philippe-Auguste et qui fut chancelier de France sous Louis VIII (roi de France de 1223 à 1226) et Louis IX (roi de France à partir de 1226).
Gauthier de Nemours surnommé « le jeune » fils de Gauthier de la Chapelle de Villebéon, devenu chambrier ou chambellan du roi, à la suite de la mort de son père en 1205.
Il aurait d’abord été chargé du soin de réparer, autant que faire se peut, les pertes subies. C’est ce que rapporte Guillaume le Breton dans sa « Philippide ».
A cette époque, le chambellan recevait les hommages rendus à la Couronne, faisait prêter serment en présence du roi et avait l’administration du trésor et des finances du royaume.
Il est probable que ces deux hommes ont œuvré à la reconstitution, au développement et à la conservation des archives royales qui reçurent le nom de Trésor des Chartes. Ce nom fut donné aux archives royales, à l’imitation des établissements religieux qui appelaient Trésor le dépôt de leurs titres.
Mais, de même qu’on ne sait rien de positif sur l’époque précise de la création du Trésor des Chartes, ne sait-on rien de certain sur l’endroit où il fut tout d’abord placé.
Il semble qu’à partir des années 1230, les documents précieux auraient été entreposés au Palais de la Cité.
A la fin du 13ème siècle, les archives et les registres de chancellerie contenant le plus souvent des chartes d’actes royaux étaient déposés dans la Sainte-Chapelle au-dessus de la sacristie et du Trésor des Reliques et des joyaux.
Qui a dit que les batailles étaient inutiles ? La sédentarisation des attributs royaux que sont les sceaux et les archives, due à la bataille de Fréteval, fera naître la charge de garde des sceaux et la notion d’archives nationales.
Sources :
- le Trésor des chartes, sa création, ses gardes et leurs travaux depuis l’origine jusqu’en 1582 : Léon DESSALLES 1844
- « l’histoire des archives s’est jouée à Fréteval » : La Nouvelle République du Centre Ouest, juillet 2017
- Wikipédia

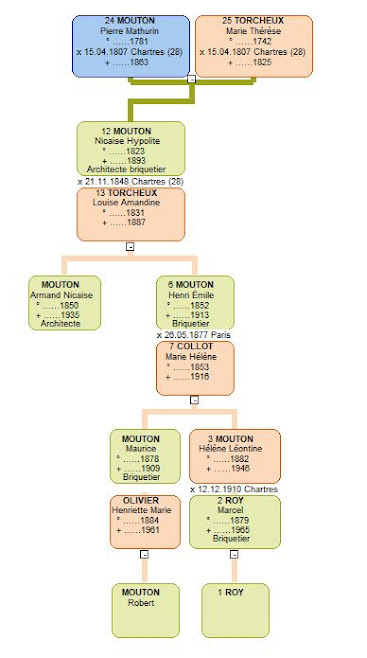

Commentaires
Enregistrer un commentaire