C comme CHIRURGIENS PARTICULIERS
Mes recherches généalogiques m’ont conduite jusqu’à BINAS, village situé en Beauce, au nord-est du département du Loir et Cher, à proximité de l’Eure et Loir, commune dont l’activité essentielle était et est toujours l’agriculture.
Parmi d’autres, une famille a retenu mon attention : aussi loin que les archives permettent de remonter le cours de l’histoire, de père en fils entre 1560 et 1674, se sont succédées 3 générations de Barthélémy CHEVALIER dont la profession était chirurgien avec, pour 2 d’entre eux, mentionnée par le curé de Binas dans leur acte de décès, une spécialité surprenante : « restaurateur de corps humains ».
1° - Barthélémy dit « l’ainé » CHEVALIER : né vers 1560, décédé le 7 ou 8 Décembre 1626 à Binas, époux de Jehanne SANGLIER vers 1580 :
« Le huitième jour de décembre 1626 a esté enterré dans l’église de Binas le corps de défunct Mr Barthélémy Chevalier chirurgien demeurant au village d’Ablainville par Monsieur le curé dudit Binas ».
2° - Barthélémy CHEVALIER, fils du précédent : né vers 1580, décédé le 26 Février 1660 à Binas, époux de Marie PISSIER vers 1604 :
« Le 27 février 1660 a été inhumé dans l’église de Binas Barthélémy Chevalier # agé de quatre vingts ans environ décédé du jour d’hier après de fort loin avoir participé en bon chrétien au saint sacrement de pénitence et du viatique du corps de notre Seigneur Jésus Christ et l’extrême onction qui luy ont été administrés par moy prêtre curé de Binas soussigné # restaurateur des corps humains demeurant à Ablainville de cette paroisse »
3° - Barthélémy CHEVALIER, fils du précédent : né vers 1604, décédé le 18 Février 1674 à Binas, époux de Anne DOUER le 1er Mars 1631 à Binas, puis époux de Anne ROUSSEAU le 27 Juillet 1652 :
« L’an 1674, le 18 Feb’ Barthélemy Chevalier # de cette paroisse, âgé de 70 ans ou environ, en la communion de notre mère Sainte Eglise a rendu l’âme à Dieu, duquel le corps a été inhumé par moy Ptre curé de Binas soussigné le lendemain de son décès dans l’église dudit Binas après avoir reçu le St Sacrement d’extrême onction et ayant été surpris de maladie subite et perdu la parole .. (2 mots illisibles) n’a pu recevoir les autres, ladite inhumation faite en présence de Mr Guillaume le Bassac, prêtre vicaire, Etienne RUAU et plusieurs autres # restaurateur des corps humains à Ablainville » (mention ajoutée en marge).
Le village d’Ablainville où les 3 générations de Barthélémy CHEVALIER exerçaient leur art, est un hameau de la paroisse de BINAS.
La mention « restaurateur de corps humain » ajoutée à la profession de chirurgien, m’a intriguée : de quoi s’agit-il ?
A la première impression, il pourrait s’agir d’un embaumeur, personne chargée de la toilette mortuaire et de l’embaumement avant l’inhumation. La toilette mortuaire existe depuis des temps immémoriaux.
Toutefois, cette explication ne semble guère correspondre aux habitudes d’une population vivant dans un village agricole, même si les terres étant riches dans cette région, plusieurs familles étaient relativement aisées.
Dans certaines régions, et notamment dans les Deux-Sèvres, le vocable « restaurateur de corps humains » remplaçait celui de bourreau, mais Binas n’étant qu’une modeste paroisse, il n’y avait probablement pas de bourreau, et la position sociale de nos Barthélémy CHEVALIER ne correspond pas à celle qu’occupaient les bourreaux qui appartenaient aux classes sociales inférieures et étaient logés à l’écart de la société.
Dans son dictionnaire des métiers, Daniel BOUCARD précise que le mot « restaurateur » se disait du chirurgien réparateur : renoueur ou chirurgien remettant les os en place.
Dès le 13ème siècle, le chirurgien est un barbier : le même rasoir taille les barbes, pratique les saignées et les petites incisions dans les corps humains (soins des abcès notamment) !
Les barbiers-chirurgiens doivent s’assurer de la bonne moralité et également de la valeur professionnelle des membres de la profession.
Ces professionnels acquièrent les connaissances nécessaires par un assez long apprentissage pratique, au cours duquel l’apprenti retient les gestes de ceux qu’il a assistés ainsi que les complications possibles avec les moyens de les éviter ou de les soigner.
Quelques règles d’hygiène sont en outre prescrites : les saignées ne sont pas pratiquées dans l’après-midi ni en public, le sang enlevé doit être jeté dans les 2 heures et il leur est interdit de soigner les lépreux par crainte de la contagion.
Ces barbiers-chirurgiens se consacrent aux soins de la barbe et des cheveux, tout en pratiquant des saignées, remède habituel de l’époque, et en soignant de petites plaies.
Le barbier-chirurgien n’a guère de connaissances médicales. Il dispose de quelques conseils médicaux, base de la thérapeutique populaire, autant dire très succincts.
C’est un artisan, faisant partie de la classe ouvrière, et de ce fait, jouissant de peu de considération. Daniel BOUCARD précise que « même saigner un malade était un acte déshonorant » !
Cependant, dès le XVIème siècle, du moins dans les villes, les chirurgiens ont commencé à se distinguer des barbiers.
En 1637, Louis XIII a créé la communauté des barbiers-barbants à qui la pratique de la chirurgie était interdite.
A cette époque, les chirurgiens doivent faire la preuve de leur savoir-faire, mais également de leur culture générale en anatomie.
Ils sont en fait les auxiliaires des médecins donnant leurs soins à ceux que ces derniers leur confient. Ils pratiquent quelques opérations, parmi lesquelles la réduction des luxations et fractures par immobilisation, la réintégration des hernies dans l’abdomen, la suture des plaies.
Il arrivait même qu’on leur fasse « fendre le corps » d’une personne morte de mort suspecte, ce qui revient à les transformer en « médecin légiste », avec toutefois des moyens et connaissances très limités.
La séparation définitive entre les 2 corps de métier ne fut consommée que sous Louis XIV par l’édit royal de 1691, et c’est la création de l’Académie Royale de chirurgie par Louis XV en 1748 qui a reconnu scientifiquement la chirurgie et règlementé la formation basée sur l’apprentissage doublé d’une formation théorique dans les facultés de médecine.
Mais là, nous parlons des villes. Qu’en était-il dans les campagnes ?
Au 17ème siècle, dans les campagnes, les soignants illettrés empiriques étaient très nombreux : soigneurs itinérants, arracheurs de dents, rebouteux, herboristes, voire même pratiquants de la sorcellerie, charlatans abusant de l’ignorance et de la crédulité de leurs « patients » !
Qu’en était-il donc de nos 3 Barthélémy CHEVALIER ?
Comment exerçaient-ils leur profession de chirurgien « réparateur de corps humains » et quelle place occupaient-ils dans la paroisse de BINAS entre 1580 et 1674 ?
Il est difficile de le savoir précisément, mais quelques indices laissent penser qu’ils occupaient une place relativement importante dans cette paroisse et qu’ils n’étaient pas de simples rebouteux regardés avec mépris.
Tout d’abord, le curé mentionne leur profession dans l’acte de décès, ce qui n’était pas l’habitude à l’époque. Il ne mentionne pas celle de barbiers, mais celle de chirurgiens en ajoutant : « restaurateurs des corps humains ».
Il est donc probable qu’il s’agissait de chirurgiens spécialisés dans la remise en état des os luxés, foulés, fracturés, comme l’indique Daniel BOUCARD, et qu’ils étaient appréciés de la population rurale à laquelle ils rendaient de grands services en cas de blessures.
Dans plusieurs actes de baptêmes et de mariages, le curé les nomme « honnête personne Maître Barthélémy Chevalier ».
A cette époque, à BINAS, les défunts étaient habituellement inhumés dans le grand ou le petit cimetière. L’inhumation dans l’église était plus rare.
Être enterré dans l’église était une tolérance accordée par les responsables religieux et les conseils de fabrique. Cette faveur était donc réservée aux personnes d’importance dans la paroisse.
En outre, il ressort de documents consultés aux archives départementales du Loir et Cher qu’ils étaient propriétaires de terres et d’immeubles, et qu’ils faisaient partie des notables.
Barthélémy CHEVALIER (le 3ème) décédé en 1674, avait épousé Anne DOUER le 1er Mars 1631 à Binas. Elle était la fille de Sulpice DOUER, notaire à Binas, et de Marie LE PAGE.
Une des filles de Barthélémy CHEVALIER et d’Anne DOUER : Anne (1648-1694) a épousé Jacques COUTANCEAU le 4 Septembre 1667 : Il était notaire à Ablainville (hameau de Binas).
Un des frères d’Anne DOUER : Sulpice DOUER (1619-1695) était chanoine de Chartres et curé-baron de Binas pendant 40 ans.
Noël CHEVALLIER, né du mariage de Barthélémy CHEVALLIER (le 3ème) et Anne ROUSSEAU (1662-1726) a également été curé-baron de Binas pendant de longues années et jusqu’à son décès. Pour la petite histoire, cet ecclésiastique n’a pas toujours suivi le droit chemin que sa fonction lui imposait :
En 1726, Le Présidial de BLOIS a prononcé une sentence le condamnant, en sa qualité d’ancien administrateur des biens de la Charité de Binas, à payer au nouvel administrateur 1355 livres, à la requête de Jan-Nicolas Chauvel, chevalier, seigneur de Croteaux, Chantôme, Binas et autres lieux.
Le curé avait été nommé administrateur par les habitants de Binas et feu le marquis de Terras, seigneur de Binas, en 1717. Depuis ce temps, il n’avait pas rendu compte des recettes et des dépenses de son administration (il avait été révoqué comme administrateur en 1721).
Dans le testament olographe de Noël CHEVALLIER, prêtre, curé-baron de Binas, entre autres clauses, il lègue à son successeur 40 livres qui lui seront payées par son exécuteur testamentaire, pour dire une messe basse par semaine : « je demande aussy pardon » écrit-il « à tous ceux que j’ay offensez et scandalisez pendant ma vie, surtout à messieurs mes confrères et mes paroissiens … ».
Noël CHEVALLIER s’est racheté en faisant don d’une maison située dans le bourg de Binas avec le jardin en dépendant « pour servir à perpétuité à y retirer les pauvres malades de la paroisse, quy est la fin pour laquelle je l’ay fait bastir, ou les y assister du revenu d’icelle dans leur particulier pendant leurs maladies … » ; Il a également légué un « corps de logis pour servir à y loger un maître d’école quy sera tenu aux entretiens dudit corps de logis », et il a légué « 3 livres de rente pour servir à entretenir un maitre d’école, a condition qu’il montrera gratuitement à quatre pauvres enfans de la paroisse ».
La lignée des Barthélémy CHEVALIER, chirurgiens restaurateurs de corps humains, s’est éteinte en 1674.
Les enfants du couple Barthélémy CHEVALIER-Anne DOUER et du couple Barthélémy CHEVALIER-Anne ROUSSEAU n’ont pas pris la suite de leurs aïeux.
Sources :
P. Cayla : « les activités professionnelles : Mémoire de la Société des Arts et des Sciences, années 1954 et 1957-1959. Article paru dans la dépêche du Midi en 2011,
WikiNiort : ASSELIN, famille de bourreaux à Niort,
Daniel BOUCARD : dictionnaire illustré et anthologie des métiers,
Archives du Loir et Cher concernant la Charité de Binas : comptes et recettes et dépenses rendus par les administrateurs de la Charité, et inventaire des titres.
P.S. : l’origine et le sens de l’expression « curé-baron » de Binas fera l’objet d’un autre article.




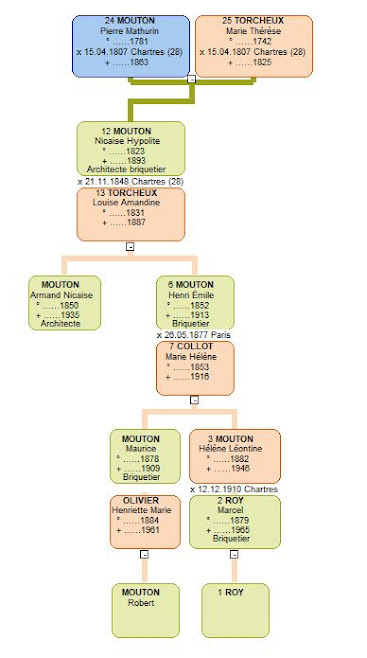

Commentaires
Enregistrer un commentaire