H comme Hiver 1709
« Hiver tueur » : le « grand hyver » de 1709
L’année de naissance de mon aïeul Joseph GUICHON père (1709) fût marquée par un hiver exceptionnel : « Le grand hyver ».
Un flux d'air polaire recouvre toute l'Europe occidentale faisant de janvier 1709 le mois le plus froid des 500 dernières années.
Tous les témoignages évoquent, que l'on n'ait jamais ressenti de mémoire d'homme un froid pareil : une punition divine annonçant la fin du monde.
Les registres paroissiaux des baptêmes, mariages et décès, tenus par les curés sont, à cet égard, une source pour apprécier l'étendue du désastre.
« Le grand hyver 1» dit tueur de moissons, ou année froide stérile et infortunée, année de la cherté, année de la misère.
Domsure, dans le département de l’Ain (01), n’y échappe pas.
Voici ce qu’a écrit Claude François CULAS, curé de Domsure pendant 39 ans, dans les « Souvenirs paroissiaux 1841-1879.
Livret commune Domsure
« Le grand hyver » 1709
L’hiver de 1709, comme celui de 1872-73, avait été très doux jusqu’au milieu de janvier : à cette époque, éclata un orage comme en 1872, et il fut suivi d’un froid intense. Tous les fruits de la terre périrent : on rebattit les pailles pour y chercher un peu de semences : la misère fut générale en France.
En cette terrible année Louis XIV, lui-même, en son palais de Versailles, mangea du pain d’avoine.
La vague de froid débute le jour des rois, le dimanche 6 janvier avec des températures, constamment inférieures à -10° jusqu'au 24 janvier (il fait -20,5° à Paris le 20).
Six autres vagues de froid s'enchaînent jusqu'à la mi-mars, chacune détruisant le peu que la précédente avait épargné. Le sol gèle en profondeur. Les noyers, châtaigniers, marronniers, sapins, fruitiers, oliviers, les vignes périssent.
Les fèves, aliments de base des populations, ne résistent pas et se gâtent. Les animaux succombent, à commencer par le bétail. Le petit gibier, lièvres, lapins, est décimé, de même que les loups, les sangliers, les cerfs, les biches et les ours.
Le froid fait geler les puits, les étangs, les rivières grandes et petites, et même les bords de mer, où les poissons périssent. Le vin gèle à la table du roi et la Cour claque des dents.
Le transport fluvial devenu impossible en raison des fleuves gelés, l'approvisionnement des villes ne se fait plus.
Paris ne reçoit aucun ravitaillement entre janvier et avril. D'une manière générale, toute l'activité économique souffre, boutiques et ateliers ferment ; procès et audiences sont suspendus.
Des feux publics sont allumés sous les halles, des distributions de soupe sont organisées. Dans les campagnes, toutes les céréales, blé, seigle, blé noir, avoine d'hiver, sont perdues.
Les pluies du printemps achèvent de pourrir les maigres récoltes que l'on pouvait encore espérer. Seule l'orge, semée au printemps, en réchappe.
Le dégel du printemps apporte une autre calamité, les inondations, compromettant encore le ravitaillement.
La rareté de l'offre venue des campagnes et des pays voisins touchés aussi par le froid, entraîne la cherté des grains, du vin, des légumes, dans les provinces.
Le prix du setier de froment est multiplié par six entre juin 1708 et juin 1709. Cette flambée des prix provoque des « émotions paysannes », comme l'indiquent les intendants. Les troupes sont envoyées.
Des bandes affamées s'en prennent aux châteaux et aux couvents, dont les occupants sont suspectés d'avoir fait des réserves. On dénombre 155 émeutes de février à juin 1709, et 38 pendant l'été.
Le 20 août, lors d'une manifestation de la faim au Palais royal à Paris, on relève au moins 40 morts. Les gens des villes font des razzias dans les campagnes. Des paysans se pendent dans les masures glaciales.
La princesse Palatine, épouse de Monsieur, frère du roi, écrit dans une lettre datée du 8 juin, « … que la famine est si violente que « des enfants se sont entre-dévorés ». Il est vrai que la misère est pire dans les campagnes que dans les villes mieux secourues.
Source : La commune dans un document ‘Souvenir paroissiaux’.
Pour aller plus loin.
L’hiver 1709 fit 600 000 morts en France.
Dès cette époque, les savants, analysent les liens entre les décès et les conditions climatiques. La mort survient de plusieurs manières :
D'abord, ce sont les maladies broncho-pulmonaires qui attaquent les populations.
La dénutrition, la malnutrition, en affaiblissant l'organisme, favorisent les épidémies de maladies infectieuses : fièvres typhoïdes, rougeole, petite vérole, dysenteries.
Enfin, les maladies propres à l'ingestion de céréales avariées, de nourritures peu appropriées herbages, racines, pain de bruyère, de farine de glands, de vesses, soupes de pois, trognons de choux, de charognes, tuent-elles aussi en nombre.
Le scorbut, dû aux carences en vitamine C, frappe également.
La piraterie, visant à arraisonner les navires céréaliers ennemis, est même encouragée.
Après 1716, le cycle solaire reprend son rythme normal.
Le XVIIIe siècle, pris dans son ensemble, montre un réchauffement général de tout l'hémisphère nord.
1 Ce terrible hiver 1709 s'inscrit dans la période que les climatologues nomment le petit âge glaciaire (PAG) qui s'étend de 1303 à 1860.

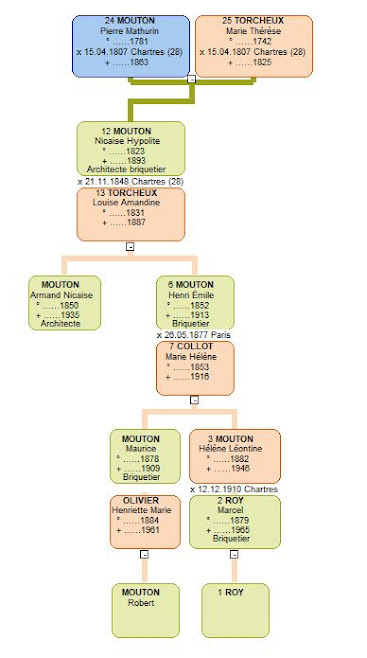

Commentaires
Enregistrer un commentaire