F comme FREYCINET
Un patronyme que je retrouve dans mon arbre généalogique
La vie de Charles Louis de Saulces de Freycinet
Il est né à Ariège le 14 novembre 1828 et mort à Paris le 14 mai 1923
Il fut ministre des travaux publics et président du Conseil.
Après des études polytechniques, il devient ingénieur du Corps des Mines avant d'être nommé fonctionnaire de l'administration des travaux publics en 1852. Il a assuré l'exploitation des chemins de fer du Midi En 1862, il s'est intéressé à l'amélioration des conditions de travail et des risques industriels à la demande du ministre des travaux publics.
|
Cette étude de six ans a été publiée en 1869 sous le titre "Traité d'assainissement industriel" Pendant la Guerre franco-allemande de 1870, il est nommé délégué à la guerre en 1870–1871 dans le gouvernement Gambetta, et refuse l'armistice avec la Prusse.
Il sera promu "officier de l'ordre impérial de la légion d'honneur" en 1870. En 1876, il est sénateur de La Seine et devient ministre des travaux publics en 1877, il fait développer le réseau des chemins de fer en amenant le train dans des régions mal desservies par les routes. Son nom est resté attaché à la modernisation des voies navigables en établissant une norme nationale du gabarit des écluses par la loi Freycinet en 1879 (40m x 5,2m) qui devient le gabarit des bateaux de canal.
La plus haute écluse Freycinet de France, l'écluse de Réchicourt mesure 15,71 m, elle remplace 6 anciennes écluses sur le Canal de la Marne au Rhin.
Document trouvé dans la base Léonore (index des titulaires de l’Ordre de la Légion d’Honneur°)
|
Freycinet présente en 1879, un plan pour le développement de l’industrie lourde Française en améliorant le transport des matières premières et du charbon : son ambition est économique et stratégique, industrielle et militaire, et entraîne la construction de nouvelles voies navigables et la modernisation du réseau : 468 kilomètres de canaux sont construits et 2453 sont modernisés.
Il a un souci de progrès général, il encourage la propulsion mécanique et le halage à dos d’homme est interdit, à la fin du 19è siècle.
|
|
Il fut président du conseil (chef du gouvernement) en 1879 et en 1885, il appuyait les thèses de Jules Ferry sur l'enseignement obligatoire et laïc. Il fut candidat à l'élection présidentielle de 1885, sans succès.
En 1886, il expulse les prétendants au trône de France, puis est battu par Sadi Carnot aux élections à la présidence de la République en 1887. Il fut le premier civil ministre de la Guerre en 1889-1890 et a allongé le service militaire à trois ans, créé l’état-major général et modernisé l’équipement militaire en faisant adopter par l’armée le fusil Lebel et le Canon de 75 Modèle 1897. Il fut par la suite éloigné du pouvoir, compromis dans la corruption liée à la construction du canal de Panama mais retrouve son strapontin au ministère de la Guerre dans le gouvernement Dupuy où il se montre anti-dreyfusard.
Président de la Commission des forces armées au Sénat, il est ministre d’État dans le gouvernement Aristide Briand en 1915-1916. Il fut élu membre libre de l'académie des Sciences en 1882 et membre de l'académie Française en 1890.
Oeuvres écrites
Traité de mécanique rationnelle (1858)
De l'analyse infinitésimale (1860 ; 1881)
Des pentes économiques en chemin de fer (1861)
Emploi des eaux d'égout en agriculture (1869)
Principes de l'assainissement des villes (1870)
Traité d'assainissement industriel (1870)
Essai sur la philosophie des sciences (1896)
La Question d'Égypte (1905)
Souvenirs (1848-1893) (1913)
Les canaux Freycinet gabarits
Le réseau français de voies navigables a une longueur de 8 500 km.
Le petit gabarit dit gabarit « Freycinet »
Il est essentiellement composé de voies de classe I, accessibles aux bateaux ayant un port en lourd compris entre 250 et 400 tonnes, ce qui correspond au gabarit Freycinet. Avec 4 000 km, ces voies constituent presque la moitié de la longueur totale du réseau.
Le moyen gabarit
Certains canaux sont à un gabarit intermédiaire, que l’on pourrait qualifier de « moyen gabarit », compris entre 400 et 1 000 tonnes. Ces voies à moyen gabarit correspondent à la classe II (400 à 650 tonnes) et III (650 à 1 000 tonnes).
Le grand gabarit
Ce gabarit, parfois appelé « gabarit belge », correspond à la classe IV (1 000 à 1 500 tonnes). Juste au-dessus se trouve la classe V (de 1 500 à 3 000 tonnes).
Le gabarit « européen »
Version plus exigeante du grand gabarit, les voies répondant à cette catégorie (classe VI ou VII)
Le tirant d’eau
Les canaux à petit gabarit (type Freycinet) ont un tirant d’eau variant de 1,8 à 2,2 m, permettant un chargement de 250 (1,80 m) à 350 t (2,20 m).
Le tirant d’eau est l’enfoncement maximal des bateaux que peut accepter une voie d’eau
Le tirant d’air
Sur les canaux à gabarit Freycinet, le tirant d’air est généralement compris entre 3,50 et 3,70 m.
Le tirant d’air est la hauteur libre sous les ponts.
Les bassins de navigation Freycinet
Les canaux Freycinet constituent souvent des liaisons inter-bassins de navigation alors que les données de trafic sont souvent présentées par bassins de navigation Freycinet.
Bassins |
Canaux |
|
Canaux de Bourgogne |
canal de Bourgogne, du Nivernais, du Loing, de Briare, latéral à la Loire et, du Centre |
870 km |
Canaux de l'Est |
canal de l’Est, canal des Houillères et Sarre canalisée, canal de la Marne au Rhin, canal de la Marne à la Saône, canal du Rhône au Rhin, embranchement de Colmar et Saône. |
1230 km |
Canaux du Nord-Pas-de-Calais |
canal Dunkerque-Valenciennes, canal de Bergues, canal de Bourbourg, canal de Calais, canal de la Colme, canal de Furnes, canal de Roubaix, auxquels il faut ajouter les rivières Aa, Lys et Scarpe. |
210 km |
Canaux de Picardie-Champagne-Ardenne |
Aisne canalisée et canal latéral à l’Aisne, Marne et canal latéral à la Marne, canal de l’Aisne à la Marne, canal des Ardennes, canal latéral à l’Oise, canal de l’Oise à l’Aisne, canal de Saint-Quentin, canal de la Sambre à l’Oise, canal de la Somme, une partie du canal de l’Est, Escaut et Sambre canalisée |
960 km |
La vie des mariniers (bateliers)
Le batelier ou marinier est un professionnel dont le métier consiste à piloter un bateau fluvial, une péniche, pousseur ou convoi fluvial naviguant sur le réseau des voies navigables intérieures (lacs, canaux et rivières).
Le marinier vit généralement à bord, dans un espace restreint, le volume dans ces bateaux étant généralement mesuré au profit de la cale (et donc du fret marchand).
Il dirige les opérations de chargement en guidant le grutier qui remplit sa cale. En aval, il surveille le déchargement et s’assure du bon équilibrage de la péniche lors de ces opérations délicates. En dehors des heures de navigation, il participe à tous les travaux de réparation et d’entretien du bateau : coque, cale, pont, machinerie. Bien souvent, il endosse la salopette de mécanicien. Avant le départ, il surveille le ravitaillement en carburant, vivres et matériel.
Pour le transport de fret proprement dit, le voyage peut durer plusieurs jours et traverser plusieurs pays. La péniche est souvent automotrice, conduite par un équipage restreint, souvent de caractère familial. Elle peut également faire partie d’un convoi de barges tractées par un pousseur. Une équipe de bateliers se relaie alors pour surveiller la navigation à tour de rôle.
Au milieu du XIXe siècle la nécessité de transporter des marchandises sur de longues distances, notamment pour les besoins de l'industrie, obligea les bateliers à "faire de grands voyages" et ils durent (entre autres pour réduire les coûts afin d'être concurrentiel avec le chemin de fer) embarquer leurs familles qui constituèrent du même coup la main d'œuvre. Les voyages lents, souvent longs, ont longtemps éloigné les enfants de l'éducation, la seule autre possibilité étant de les placer dans des internats (LILLE ou DOUAI, voir en Belgique).
Les conditions de vie ont été difficiles jusqu'au milieu du XXe siècle.
La capitale française de la batellerie est Conflans-Sainte-Honorine. Le Musée d'intérêt national de la batellerie y a été créé en 1965. Le pardon national de la batellerie s'y déroule chaque année depuis 1960.
L'écluse "Freycinet" de Frouard, près de Nancy
Coupe du « bateau », jargon des mariniers
Logement principal chambrée des garçons
Ils sont très fiers de leur bateau (leur outil de travail) et en général, le « logement » est très coquet. D’ailleurs pour y descendre, on se déchausse et on met les chaussons !
logement
Plan du logement
Et oui je peux vous en parler, car je fais partie d’une famille de batelier (côté paternel et côté maternel). En 1957, mes parents ont décidé d’arrêter le métier trop difficile surtout avec 4 enfants et ont « descendu à terre ». Ils se sont installés dans la ville de Béthune où je suis née, ville habitée par de nombreux mariniers en retraite (tout un quartier).
Cette vie spéciale m’intriguant, je me décide à ma retraite (comme beaucoup de monde) de me lancer dans des recherches généalogiques. Je découvre plus en détail ce métier en interviewant mes parents, mes grands parents, mes oncles et tantes. Je me souviens que pendant mes vacances scolaires, mes grands parents, oncles et tantes m’emmènent « faire un voyage ». La distance n’est pas très longue mais le voyage peut durer quelques semaines : ballade au fil de l’eau.
Bref, imaginez ma surprise lorsque je trouve l’acte de naissance de mon grand-père paternel.
Vous pourriez me dire, c’est logique ! Pas vraiment car mon grand-père a 11 frères et sœurs, tous nés à Dunkerque mais au bassin Mardyck.

Bassins Freycinet
Mais petit dernier détail croustillant : j’ai travaillé dans une verrerie dans l’Oise. Le deuxième site de production est à Arques près de Saint-Omer (partie de Cristallerie d’Arques rachetée par la société Saverglass). Mes grands-parents et mes parents étaient régulièrement affrétés pour le voyage Béthune-Arques et y déchargeaient du sable (pour la fabrication du verre).
Mon supérieur hiérarchique se nommait «P. Freyssinet ». Il est passionné de généalogie depuis plus de 30 ans et m’a transmis le virus.
La boucle est bouclée …
Ci-dessous, quai de déchargement et au fond, l’ascenseur des Fontinettes (ascenseur à Bateaux) que j’ai emprunté avec mes grands-parents (souvenir impérissable).
|
Ascenseur vu du ciel
La ville d'Arques dans le Pas-de-Calais n'est pas seulement réputée pour sa cristallerie. Elle possède une machine étonnante et unique en France : un ascenseur à bateaux. Construit en 1887 sur le canal de Neuffossé, il a permis aux bateaux et péniches d'éviter le passage de cinq écluses. Une construction exceptionnelle, véritable témoin du génie mécanique du XIXe siècle. Fonctionnant sur le principe d'une balance hydraulique à deux pistons, il fut utilisé jusqu'en 1967, date à laquelle une écluse grand gabarit le remplaça. L'ascenseur en lui-même ne se visite pas mais ses annexes vous donnent l'occasion d'en comprendre le fonctionnement à travers une salle d'exposition, un atelier de réparation et une salle vidéo.
Certains me connaissent, ils comprendront maintenant ma passion des voyages.
En tout cas et en conclusion, la généalogie nous permet tous ces voyages (réels ou virtuels). C’est une source de découvertes (bonnes et moins bonnes) mais tellement enrichissantes.
Et pour finir, comme dit la chanson de Desireless : « voyage, voyage ! »
Sources : Wikipédia, base Léonore, Mappy, Archives départementales du Nord, livre « l’immigration oubliée des Belges en France aux XIX et XX siècles de Jean Pierre POPELIER, édition Archives et Culture












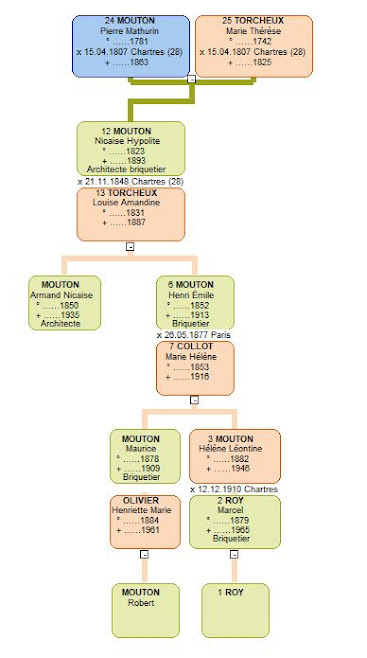

Commentaires
Enregistrer un commentaire