C comme Condamnation
François Marsac (mon Sosa 94) est décédé le 22 février 1813 à Paimboeuf, en Loire Inférieure. Il est né le 24 juin 1767 à Couëron, aussi en Loire Inférieure. Et il s’est marié le 20 janvier 1795 au Pellerin avec Véronique Chauveau (Sosa 95). Il habite depuis au village du Pé de Buzay. Alors pourquoi est-il mort à Paimboeuf en prison, puisque son décès est déclaré par le concierge de la prison ?
Quel délit a-t-il commis ?
Une visite aux archives départementales de Nantes et après la consultation de plusieurs registres, je retrouve le dossier d’instruction.
Ce dossier d’instruction est ouvert suite à la dénonciation écrite de Jean André Nivellain , adjoint au maire de la commune du Pellerin et commissaire de police, pour attester des extravagances du Sieur Marsac envers sa femme, ses enfants, François Jean (16 ans), Marie Véronique (14 ans et sosa 47) et Véronique (12 ans), son beau-frère Louis Chauvet et plusieurs voisins. Le commissaire dit l’avoir convoqué lui et sa femme, « qui est la plus malheureuse de toutes les femmes », et l’avoir sermonné. Il a promis « de se soumettre à un genre vie plus honnête et de faire une meilleure union avec sa femme et ses voisins ».
Mais le 17 juin suivant, il traine sa femme dans le village, comme si elle était morte. Ses voisins la secoure et la conduise chez sa mère. Mais le 25 juin, François Marsac va armé d’une barre de fer, pour essayer de tuer sa femme. Il la ramène chez lui.
Le 26 juin, Véronique Chauveau requière l’officier de santé, René Vieillechèze. Il vient à son chevet et constate une forte fièvre, de nombreuses blessures et contusions suite à des mauvais traitements et des coups portés par un objet contondant. Il établit un certificat en n’espérant pas une parfaite guérison avant au plus tôt une quinzaine de jours.
Le 7 juillet, François Marsac est chez son beau-frère Louis Chauvet. Il veut le retour à son domicile de sa fille Marie, qui une fois de plus s’est réfugiée chez son oncle. Il tente de s’emparer du fusil de ce dernier, Louis essaie de l’en empêcher et François lui saute dessus, le renversant sur le lit puis à terre. Aux cris que font les belligérants, les voisins accourent et les séparent. Louis fait intervenir l’officier de santé, qui de nouveau établit un certificat de coups et blessures et une huitaine de jours pour une guérison complète.
Le 11 juillet 1812, le procureur impérial, établit un mandat d’amener au nom du sieur François Marsac. Le maréchal des logis de gendarmerie impériale, Collignon, établi à Vue, est chargé de procéder à l’arrestation. Ce qu’il fait le 12 juillet sans résistance de la part de François.
Le 13 juillet, François Marsac est placé sous mandat de dépôt à la prison de Paimboeuf en attendant son procès.
Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Paimboeuf, Loire Inférieur, est saisi et demande à auditionner des témoins. Ils sont sommés de se présenter au juge de paix du Pellerin afin que leur témoignage soit consigné par écrit. Certains de ces témoins certifient avoir vu ou entendu les menaces, « je vais tuer ce petit monsieur », comme il appelle son fils, et les injures envers sa femme. Ils ont vu aussi les coups et les blessures infligés par François Marsac en particulier à sa femme, mais aussi à ses enfants, si bien que Véronique en sera toute « chamboulée et gardera le lit 3 jours ». Son fils s’est enfui du village pendant 4 jours par crainte de son père. Sa femme et sa fille Marie se réfugient régulièrement chez des voisins qui les accueillent pour 2 ou 3 jours. Sa femme retourne aussi chez sa mère, Anne Bonfils (sosa 191) pour dormir chez elle, mais son mari vient toujours la rechercher pour qu’elle revienne à la maison. Quand il est en fureur il prend, « fourche à deux doigts», « couteau à deux mains », « bâton appelé aussi court breton » « marteau de quatre ou cinq livres » en poursuivant sa femme ou ses enfants ou pour essayer de s’introduire chez ses voisins. Tout le village est sur le qui-vive et a peur. Un soir il s’introduit chez Jean-Baptiste Chiché pour lui dérober un fusil et un pistolet. Les domestiques l’arrêtent.
Ces faits se sont intensifiés depuis 6 mois et François Marsac devient dangereux pour sa famille. Les témoins certifient également qu’il boit beaucoup, jour et nuit et qu’il est saoul en permanence « si bien qu’il est probable qu’il se ruine la santé et qu’il n’en a pas pour très longtemps ». Le commissaire atteste qu’il y a eu plusieurs plaintes contre lui, qu’il a même dansé sur une table dans un café du Pellerin « écrasant les verres avec ses pieds » et montrant « sa nudité ». Sa femme s’est plainte aussi d’avoir été obligé de vendre des biens qu’elle a en propre pour qu’il puisse s’acheter toujours plus d’alcool. Il ne travaille jamais, laissant seuls aux champs sa femme et son fils. Un témoin affirme également que le prévenu lui a raconté avoir un soir dansé avec le diable. Il chante aussi un livre à la main, alors qu’il ne sait pas lire. Il veut vendre tout son mobilier et demande au curé de l’annoncer en chaire, ce que le prêtre refusera de faire.
Le 15 juillet 1812, François est interrogé par le juge d’instruction sur les faits qui lui sont reprochés. Il nie battre sa femme et ses enfants et dit que c’est lui qui est battu par son fils qui lui lance aussi des pierres. Il nie s’être rendu chez les voisins et les avoir menacer. Par contre, il confirme la présence du diable dans sa maison un soir de carnaval dernier.
Témoignage de François Marsac sur la présence du diable à son domicile
Le 20 juillet, il est de nouveau interrogé sur son altercation avec son beau-frère Louis Chauvet. Il répond qu’il est bien allé chez son beau-frère, qu’il a voulu s’asseoir à table et que Louis Chauvet le lui a refusé en l’injuriant, mais qu’il ne molesta pas son beau-frère, qu’au contraire c’est lui qui reçut des coups.
François Marsac est condamné à 2 ans de prison, 16 francs d’amende et aux dépends.
Tribunal de 1ère instance de Paimboeuf en 1810, rue Neuve, aujourd’hui rue Pierre Jubau.
Un corps unique, exceptionnellement double en profondeur, compose la maison. A partir d'un large vestibule servant de salle des pas-perdus, un escalier en charpente, ancré dans-œuvre à l'angle sud-est, conduit, à l'étage, à la salle d'audience dont le plafond a été exhaussé. Les ouvertures carrées du comble à surcroît ont été masquées du côté de la rue, laissant supposer une division du comble : un comble servant de grenier du côté de la rue et trois pièces habitables du côté de la cour. Deux pavillons couverts d'un toit à croupes ont été élevés au sud de chaque côté de la cour.
Prison de Paimboeuf rue Pierre Chevry
Porte de la prison seule subsistante à l’heure actuelle
Un chemin de ronde entourait la prison accessible par une porte monumentale au nord, seul élément subsistant du mur d'enceinte. La prison désaffectée a été divisée en logements. Une prison est signalée au haut Paimbœuf dans le troisième quart du XVIIe siècle, en rive de la Loire. Elle est représentée en plan masse sur le projet de port dressé par l'ingénieur Groleau en 1778 et sur le premier cadastre (1810), caractérisée par deux saillies arrondies du côté de la rue (parcelle 285). Il semble qu'elle ne soit plus utilisée comme prison dans le dernier quart du XVIIIe siècle ; la moitié d'une maison nommée la vieille prison est louée par des propriétaires privés à un sabotier en 1787. En 1817, le registre des propriétés bâties la désigne toujours comme : la vieille prison. Elle était située en face de la maison actuellement adressée n° 32 quai Chassagne. L'ancien tribunal de la juridiction de la Guerche (anciennement 4 rue de la Vierge) a servi de prison jusqu'au deuxième quart du XIXe siècle. En 1809, Mathurin Crucy semble avoir été le premier architecte du département sollicité pour la construction d'une nouvelle prison. Le projet reste sans suite et seule l'acquisition de la maison d'angle mitoyenne à l'est du tribunal sera acquise pour servir à l'incarcération des femmes (20, 22 rue de l'Hôpital). Un nouveau projet est présenté le 10 juin 1820 par Jean-François Ogée (architecte du département) pour la construction d'un ensemble prison et gendarmerie à l'emplacement du cimetière de l'hôpital (au sud-ouest de la rue Constant-Riou) ; l'emplacement n'est finalement pas retenu. Le projet définitif, présenté par Saint-Félix-Seheult (architecte du département), voit le jour le 10 février 1834 au sud de la caserne de gendarmerie installée dans l'immeuble à logements 27, rue Pierre-Jubau. Ce dernier emplacement avait été préféré au terrain situé au sud du chevet de l'église paroissiale. En 1836, sont validés le dessin d'une petite place au nord de laquelle on accédait par une porte monumentale à la maison d'arrêt et l'alignement de la rue du Bois Gautier (actuelle rue Pierre-Chevry). La parcelle sur laquelle a été bâtie la maison d'arrêt faisait partie en 1811 des terres dépendant de la métairie du Bois Gautier appartenant à la famille Leroux de Commequiers résidant à Nantes ; elle servait de parc aux fumiers.
François mourra donc en prison, 7 mois après son incarcération. Rien sur son acte de décès n’est mentionné concernant la cause de sa mort. On peut peut-être, supposer que vu son état de santé avant jugement, peut-être celui-ci s’est-il dégradé, entrainant sa mort.
Véronique Chauveau, sa femme décèdera en 1852, à 87 ans, après avoir enterré en 1817 sa fille cadette Véronique à l’âge de 16 ans.
Son autre fille, Marie Véronique, mon ancêtre, se mariera en 1825 et aura 3 enfants.
Son fils François, se mariera en 1821 et aura lui aussi 3 enfants.
Marie-Armelle Boucard





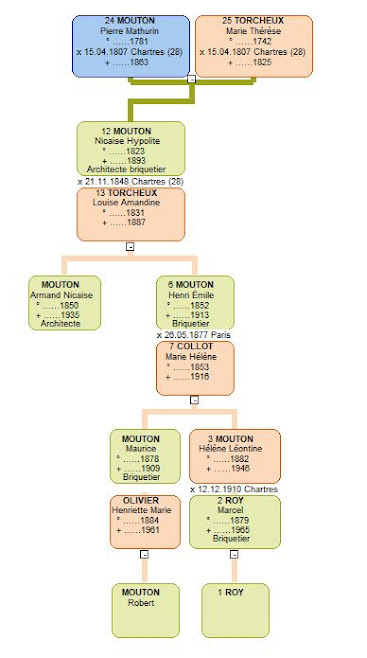

Commentaires
Enregistrer un commentaire